Notre expertise
Expérience
EXPERTISE EN PRÉVENTION
EXPERTISE EN PROMOTION/ ÉDUCATION
EXPERTISE EN ENVIRONNEMENT
CONCEPTION, RECHERCHE, RÉDACTION
ÉCRIT & ÉLECTRONIQUE
Photo LMEA: La bouche en raisins, Qc. 2008
Les sujets qui concernent la prévention, l'éducation à la santé et en droits humains ainsi que tous les projets pertinents d’éducation pour la santé sont du champ d’expertise et d’intervention de Le monde est ailleurs. Selon les besoins identifiés, nos experts en contenu ou en communication interviennent du concept à la livraison finale..
MORCEAUX CHOISIS: INTERVIEWS
APPRENTISSAGES
TDAH: Réflexions et conseils
2016
Avec Normand Baillargeon et Jean-Francois chicoine
Source: A Babord No 62 - déc. 2015 / janv. 2016
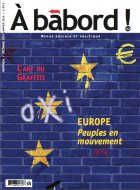
Normand : Dr Chicoine, je tenais faire appel à vous pour nous éclairer sur toute cette polémique autour du TDAH que suivent de près les personnes œuvrant en éducation, mais qui reste pour elles bien complexe. Mais dites-nous d’abord qui vous êtes et d’où vous parlez sur ces questions.
JFC : Je suis un peu la pomme sous le pommier. Mon père était pédiatre, ma mère, travailleuse sociale, tous deux œuvraient à Sainte-Justine où je suis né, j’ai grandi, je soigne et j’enseigne aujourd’hui au département de pédiatrie. Je suis d’abord un clinicien, forgé aux enfants d’ici, à l’urgentologie en France, puis à la santé internationale dans les orphelinats du monde. Droits, négligences, abandons/adoptions, attachements, familles, développement du cerveau, scolarisation, cultures, etc., la science et l’humanisme sont mes référents corporels et passionnels. Autrement, j’espère bien être un éducateur. J’aime beaucoup ma vie, l’imagination des petits, les agoras, les débats, les médias et le cinéma, pour le mouvement. À 24 images/seconde, je fais des diagnostics. Sur une chaise, je bouge beaucoup. Trop?
Normand : Permettez qu’on pose brutalement ces questions. À votre avis, le TDAH est-il essentiellement une «construction sociale» ou cela renvoie-t-il à une condition objective, sans doute biologique? Comment le sait-on? Et si c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne, comment expliquer l’attrait des thèses qui en font un phénomène très massivement culturel.
JF : Les conditions objectives naissent du social, mais ne s’en séparent jamais tout à fait, et surtout pas en médecine, dont l’ambition est de soigner selon les données les plus probantes, mais aussi en fonction des désirs des personnes et leurs sociétés. Pour répondre « brutalement » à votre question, chercheurs, neuroanatomistes, pédiatres, etc., conviennent très clairement que le TDAH est immaturité génétique (ex. dans les familles), développementale (ex. la négligence affective) ou d’origine lésionnelle (ex. un traumatisme crânien) avec, et c’est là que ça se complique, des symptômes plus ou moins dérangeants, dans des écosystèmes plus ou moins prédisposant ou accompagnant (ex. la pauvreté, la cigarette durant la grossesse, la prématurité, la malnutrition infantile). Le TDAH, en fait, est un modèle d’épigénétique, ce qui contribue à élargir la palette de ses représentations, conséquemment de ses mythologies.
Quand les réalités factuelles se radiographient mal, sans mesures biologiques accessibles, et quand elles sont hétérogènes, en plus d’être courantes, comme c’est le cas avec les troubles d’apprentissage, de comportement ou en santé mentale, l’individuation science-culture est encore plus laborieuse. La reconnaissance du TDAH comme trouble neurodéveloppemental est relativement neuve, ne l’oublions pas. Elle émerge avec la conquête de l’espace et a encore ses comptes à rendre à ses sociétés-mères dont elle ébranle l’amour-propre en accusant The cortex frontal, fierté de l’humanitude, d’inattention, d’inflexibilité et de désinhibition et, ce, selon un guide normatif réglé à ma même sa propre médecine et par ses propres juges. Avouez que c’est provocant, que cette apparence de franc-maçonnerie génère la rumeur : qu’est-ce que la normalité? Y a-t-il complot? Quand Hippocrate fait valoir que la crise d’épilepsie n’est pas divine, ses disciples mettent 2400 ans pour finir d’en convaincre le bon peuple, et encore, pour le shaman, rien n’est réglé! En occident, le débroussaillage horizontal a encouragé des observations, des dissections, des expérimentations, non sans menaces culturelles ou religieuses à la liberté des découvreurs, mais permettant progressivement, dans la deuxième moitié du 19e siècle, l’idée scientifique, son expérimentation et sa reproduction avec la méthode expérimentale de Claude Bernard. Sans ces lentes avancées, pas de cette médecine basée sur les preuves dont bénéficie aujourd’hui le diagnostic du TDAH, à travers ses critères diagnostiques, ses guides de pratique, ses questionnaires validés, sans oublier la rencontre clinique qui est en soi un vif éclairage sur la nuisance du trouble au quotidien, en classe, dans le couple. Les progrès scientifiques procèdent toutefois en discontinu, avec des fenêtres temporelles d’exception, dont une dernière en date, qui a fait le plus grand bien à la légitimité du TDAH : les neurosciences. Grâce à la neuroimagerie, par exemple, on sait maintenant que le cerveau des individus souffrant de TDAH, n’est pas aussi inhibé que celui d’un groupe contrôle et que cet encombrement nuit à sa mémoire de travail. On peut aussi jauger le trouble avec une précision épeurante par des épreuves psychométriques en psychologie et en neuropsychologie à recontextualiser dans le contexte clinique. Pardonnez cet argument d’autorité, mais on m’a consulté pas moins qu’hier pour une petite fille de 8 ans dont, au terme de ma consultation, j’étais certain du diagnostic de TDAH…mettons à 99 %. Le 1 %, c’était pour la culture!
Merci de ces précisions et de ces nuances. Ce texte sera lu par des parents et par des enseignant.es. Commençons par les premiers. Leur enfant vient de recevoir, de l’école ou d’un médecin généraliste, un avis de possible TDAH. Que leur conseillez-vous de faire?
De ne pas se braquer, ce qui serait un réflexe naturel. Reconnaitre, puis soigner un TDAH, c’est adapter un cerveau en puissance à un monde formidablement exigeant. Rien n’est moins naturel. Un seul programme : l’apaisement d’un « ici et maintenant » dorénavant intenable. L’anxiété, la colère, le déni et, pire, la honte, tout cela est bien humain, mais ne mène nulle part (ex. « Certain que c’est du bord de son père… », « Pourquoi on n’a pas consulté avant? », « La voisine l’avait dit. »). En consultation, des pèrémères sanglotent voyant que leur enfant va engraisser la statistique, c’est attendu, car un parent aimant veut à tout prix éviter que son enfant souffre de ses insuccès. D’autres familles, si ça trouve, vivent du soulagement (ex. « Elle n’était jamais invitée à des anniversaires », « Enfin des trucs pour qu’il se ramasse », « Elle va prendre gout à la lecture… »). Leur enfant n’est pas un mauvais petit, leurs questionnaires de dépistage (ex. Conners) vont dans le même sens que ceux remplis par l’enseignant, enfin l’impression clinique du médecin les conforte dans ce qu’ils avaient entendu autour de la question et, oui, ils vont pouvoir faire quelque chose de signifiant pour magnifier l’estime de soi ou faciliter les devoirs de leur progéniture. Afin de fignoler le diagnostic, il y aura cependant des croutes à manger, et sans trop trainer « dans le système », c’est ma manière, car il faut absolument éviter que perdurent la mésestime de soi et les conflits générés par l’agitation ou la mèche courte. Le TDAH n’a pas la gravité d’une méningite, mais son repérage complexe et l’intrication de ses avenues thérapeutiques environnementales, cognitives ou pharmacologiques en font un réel trouble tertiaire, c’est-à-dire nécessitant une approche interdisciplinaire concertée et songée. Le psychologue hospitalier ou scolaire devrait être mis à contribution, notamment pour des mesures psychométriques, sinon, coupures ou comorbidités obligent, il faudra consulter dans le privé, un neuropsychologue par exemple. L’expertise d’un généraliste familier avec le TDAH, d’un pédiatre ou, en présence d’un trouble anxieux ou des conduites, d’un pédopsychiatre, est primordiale. Des habitudes de vie devront être questionnées : les heures de sommeil, les habitudes d’écrans dont la télé et les jeux vidéo, la place de l’activité physique et du plein air, les soupers en famille, la discipline au quotidien. Des prescriptions de vie scolaire pourront être discutées par les parents avec l’équipe professorale. Enfin, aux côtés des mesures environnementales, une médication sera souvent prescrite. Parfois, on trouve vite la bonne, autrement, c’est du bricolage intelligent, mais on y arrive, en mesurant les effets contrôlants et en jaugeant les effets secondaires possibles en continue. Au besoin, un orthopédagogue dans un rapport 1/1 complète la prise en charge pour montrer à l’écolier comment mieux lire dans son cerveau, ce qui pourrait faire l’envie de pas mal d’adultes.
Trois brefs conseils aux enseignant.es, pour finir?
Un, devenir incontournable pour l’enfant : s’approcher physiquement de lui, même s’il a la bougeotte, s’accorder avec son regard, même s’il est impulsif, formuler clairement des consignes, même s’il est inattentif, se sentir ange, mais continuer d’agir comme un poids lourd, répéter ad nauseam, même en l’absence de réussite ou d’enthousiasme, bref le contenir, l’empêcher de trop se répandre. Deux, dans la continuité de sa famille et du plan d’intervention proposé par le psychologue scolaire, simplifier le monde pour lui : établir des routines fichées, écrites et visibles, utiliser des pictogrammes, des mots de passe complices pour lui éviter de tilter, lui donner un peu plus de temps pour effectuer ses examens, formuler clairement des règles de vie, ne pas le punir ou l’humilier, installer plutôt des conséquences, maintenir. Troisième brève, celle-ci dans la résistance, effacer le tableau noir du malheur que réserve dorénavant le Québec aux faux et vrais diagnostics de TDAH ainsi qu’aux marginalités d’apprentissage qui les accompagnent, rester debout devant et pour l’enfant, au besoin en parler à une grande oreille autour de soi, puis, avec la permission de ses parents, et l’équipe scolaire, appeler son médecin pour en jaser, ça devrait lui faire plaisir. Dans l’adversité, combattre le mal par le mal, donc bouger beaucoup. Continuer de bouger seul et collectivement pour les actions éducatives.
ENVIRONNEMENT
Perdus sans la nature: entrevue avec François Cardinal
2010
Par Frédérique Sauvée
Source : Extrait de Espaces, septembre 2010
Québec, 2010
Une récente étude de la National Wildlife Federation (NWF) montre qu’un enfant américain passe en moyenne quatre à sept minutes par jour à jouer dehors, alors qu’il est recommandé de pratiquer une activité physique quotidienne d’au moins 20 minutes. Peut-on établir le même constat chez les jeunes Québécois ?
Aucune étude de ce type n’a encore été menée au Québec, mais on observe souvent chez les Américains des tendances qui vont toucher un peu plus tard les Québécois. Pour écrire mon livre, je me suis fié à bien des études internationales et à des entrevues avec des experts de tous horizons, dans le but de vérifier ces données que l’on trouve dans les études américaines. Unanimement, les experts m’ont dit que les jeunes occidentaux ont de moins en moins accès à la nature et consacrent de moins en moins de temps au jeu libre.
D’où vient ce phénomène ? La console de jeu vidéo est-elle devenue plus séduisante que la cabane dans les arbres ?
La stimulation d’un jeu vidéo est aujourd’hui bien plus grande que la nature. Il est plus facile de s’asseoir devant un écran et de s’engourdir l’esprit devant des images qui défilent à toute vitesse que d’aller à l’extérieur et chercher des insectes. Les parents organisent de plus en plus les horaires de leurs enfants, qui ont de moins en moins de temps pour le jeu libre ou de se promener à l’extérieur afin de rester en contact avec la nature. À mon époque, nous étions laissés à nous-mêmes, nous partions toute la journée jusqu’à ce que notre mère nous appelle pour manger, puis nous repartions tous jouer encore quelques heures. Or, aujourd’hui, les enfants n’ont plus ce temps libre où ils doivent s’organiser par eux-mêmes. Les seuls moments où ils peuvent vraiment faire ce qu’ils veulent, ils vont les passer devant leurs jeux vidéo. Et il ne faut pas oublier cette culture de la peur dans laquelle on vit aujourd’hui. On est passé en quelques décennies d’une société de prévention à une société de précaution. Les enfants sont couvés à l’excès. L’autonomie qu’on leur laisse est de moins en moins grande, car il est toujours plus facile et sécurisant de les laisser entre quatre murs.
Vous êtes vous-même père de famille. Comprenez-vous ces parents qui sont anxieux de voir jouer leur enfant dehors ?
Oui je les comprends, mais je sais aussi qu’il est de leur responsabilité de sortir leurs enfants de leur zone de confort. Prenons un exemple comme celui du transport à l’école. C’est de plus en plus en automobile que les parents y amènent leurs enfants. C’est assez désolant comme constat, car ces jeunes perdent en autonomie, en débrouillardise et en activité physique. Il faut comprendre ces parents qui ont peur que leurs enfants aillent à pied ou à vélo à l’école : il y a de plus en plus d’autos, donc de plus en plus de risques d’accident. Mais les transporter dans une auto pour les amener à l’école, c’est entretenir un cercle vicieux où pour répondre à un problème, on en crée un encore plus grand. Il existe pourtant des solutions comme le pédibus : un concept très en vogue en France, où les gens d’un quartier s’organisent entre eux pour avoir un circuit jusqu’à l’école, comme celui d’un autobus scolaire, mais que les enfants empruntent à pied encadré par les parents volontaires. Vous avez là les vertus de l’activité physique sans la crainte de laisser son enfant seul dans la rue parmi les autos.
Quelles sont les conséquences d’un manque d’exercice et de plein air ?
On parle de plus en plus d’obésité, d’hypertension, de diabète. Des problèmes qui n’étaient pas des problèmes d’enfants auparavant, mais qui commencent à être alarmants. On constate généralement une dégradation de la forme physique, mais aussi l’apparition de troubles mentaux comme l’hyperactivité, les difficultés d’attention, les désordres liés au stress et les troubles du comportement. Tout cela parce que les enfants n’ont plus de moments de jeu libre pour canaliser leur énergie.
Quels sont les bienfaits de ce « jeu libre » dans la nature ?
L’ergothérapeute Francine Ferland en parle comme d’une « supervitamine » pour les enfants. Une étude a été réalisée auprès d’enfants atteints de trouble de déficit de l’attention qu’on a amenés dans un parc se promener pendant une vingtaine de minutes. On a conclu que l’impact de la nature est aussi important, voire plus important, qu’une pilule de Ritalin. L’être humain a une affinité innée pour la nature : elle lui procure du bien-être. Plusieurs études le prouvent. Au Japon, par exemple, les gens qui vivent à proximité d’un parc ont une longévité plus grande que les autres. Autre exemple : les enfants qui voient la nature par une fenêtre pendant qu’ils font leurs devoirs ont un degré de concentration et d’attention plus important que ceux qui regardent un mur de briques. Vous avez là des liens entre la nature et le développement des enfants. Leur santé physique et cognitive en dépend.
Parents et enfants doivent donc réapprendre à s’intéresser à la nature ?
C’est bien beau de penser que les enfants sont plus soucieux du sort de la planète parce qu’ils ferment le robinet lorsqu’ils se brossent les dents ou parce qu’ils trient les déchets et les matières recyclables… Mais on oublie une chose : tant que l’on ne développera pas l’intérêt des enfants pour l’environnement, on se dirigera tout droit vers un mur. Si aujourd’hui nos enfants n’ont plus d’expérience en pleine nature, on ne peut pas espérer qu’ils seront de meilleurs protecteurs de l’environnement que nous. Il faut que les parents retrouvent cet intérêt et qu’ils le transmettent à leurs enfants, qu’ils deviennent des modèles. On n’a pas besoin d’aller très loin de la maison ou de faire des activités extraordinaires pour donner aux enfants le plaisir de la nature. Avec mon fils, j’ai pris l’habitude de planter notre tente dans la cour arrière de notre maison et d’y dormir avec lui certains soirs. Ce sont pour lui des souvenirs impérissables et une expérience en soi.
GARDERIES
Le bébé et l’eau du bain: entrevue avec Jean-François Chicoine
2006
Par Mamanpourla vie.com
Source : Extrait du site WEB Mamanpourla vie.com
Québec, 2006
En 2006, lors de la sortie de Le bébé et l’eau du bain, le magazine Web Mamanpourla vie.com interviewait Jean-François Chicoine et Nathalie Collard, à commencer par cette première question pour Jean-François Chicoine : Quel est le message le plus important pour vous?
Le message le plus important pour moi est que le parent est la personne la plus importante pour son enfant et qu’il est autorisé à parler pour son enfant et qu’il devrait être autorisé à prendre du temps avec son enfant. Il devrait être un pivot central dans nos sociétés, pour les employeurs (avoir du temps protégé pour les enfants), pour le réseau de santé (cours post-partum intelligents, disponibilité des services et des évaluations) et pour l’État pour éventuellement subvenir aux besoins de ce qu’il est.
Le parent est un peu dépossédé de ses décisions, il est vu d’en haut, il est culpabilisé et les femmes sont bonnes là-dedans parce qu’elles ont plus d’instinct et un sens de la responsabilité qui s’est ancré en elles dans les premiers de la vie de leur enfant. Comme elles prennent tout sur leurs épaules et qu’elles ne savent plus nécessairement à qui le confier – avec raison je dirais parce qu’elles veulent le protéger —, et un moment donné elles finissent par craquer ou par vivre la vie qu’elles n’auraient pas nécessairement souhaité vivre, qu’elles veuillent retourner sur le marché du travail ou rester à la maison.
Premièrement pour des raisons biologiques. L’enfant a une structure particulière à développer dans son cerveau et il est, comme un papier buvard, extrêmement sensible aux environnements. Si la maman ne peut pas garder son bébé au-delà de ses 8 premiers mois – il est primordial que ce soit la maman assistée du papa qui s’occupe du bébé durant cette période -, il faut absolution que la personne choisie soit un équivalent à la mère. Il faut que cette personne puisse fournir, aux niveaux sensoriel, moteur et émotif, assez de stimulations et de sécurité à l’enfant pour que ses neurones, ses axones puissent bien se développer, pour qu’il puisse avoir l’équipement nécessaire pour ensuite réaliser sa vie. Ces phases sont importantes au départ pour que la maman s’attache à l,enfant et que tranquillement, l’enfant s’attache à des individus : ses parents ou une gardienne qui est proche de lui ou une éducatrice en CPE, mais pas avec le roulement auquel on s’est habitué, pas avec le nombre d’heures auquel on doit composer ni avec la rigidité avec laquelle on a mis sur pied notre système de services de garde.
Vous faites référence à l’obligation du temps plein, 5 jours avec un minimum d’heures chaque jour?
C’est quelque chose qui m’a énormément choqué et que j’ai trouvé inacceptable. En fait, c’est ça qui m’a donné le souffle pour écrire le livre. Je me suis dit, si on en est rendu, comme État, à vouloir contrôler ce qu’une maman veut faire avec son enfant… Je me suis dit, ça ne marche pas là, il faut qu’il se passe quelque chose!
Quel est le danger qui guette l’enfant?
En fait, la plupart des enfants, même si tout est fait de travers, vont quand même bien s’en sortir parce que le plus important au bout du compte, c’est le couple parental. Une heure ou deux ou trois le soir et le weekend vont imprimer son style affectif à l’enfant et lui donner une base de sécurité importante. Par ailleurs, si l’enfant – et ça, c’est très clair -, surtout à partir de l’âge de 9 mois, voit trop de figures d’attachement cet enfant-là va se dire « je suis un très bon bébé, je suis un moyen bébé ou je suis un bébé qui n’e vaut pas la peine… », et à partir du moment où il se dit ça, il confie de moins en moins sa survie à l’adulte qui s’occupe de lui et il essaie lui-même de s’occuper de ses affaires.
Gérer ce stress-là peut atteindre les cellules cérébrales et ça atteint aussi la manière dont l’enfant se comporte avec l’adulte. Ou il devient très anxieux, il crie, on est souvent obligé de le changer de lait, il a des troubles du sommeil, il fait des crises au centre d’achats, ou ça fait un bébé qui est jours sous les jupes de sa mère et qui a de la difficulté à s’en séparer, qui est indisciplinable, ou encore un enfant qui est plus violent, plus agressif, plus enragé et qui n’écoutera pas plus son professeur qu’il écoutait son parent parce que justement il ne fait pas confiance. Il va éventuellement avoir un problème de confiance en lui, d’estime de soi, d’estime des autres…
Ce n’est pas tous les enfants; 10, 20, 30 %, on ne sait pas. La seule chose qu’on sait maintenant – et c’est un des messages importants du livre – c’est qu’il y a une continuité dans les modèles affectifs avant 18 mois, dans la petite enfance, dans l’enfance et à l’adolescence pour toute la vie. Ce qu’on est avant l’âge de trois ans est quelques chose qu’on peut retrouver à 30 ou 40 ans! Le cerveau se développe à 95 % jusqu’à l’âge de 3 ans.
Qu’est-ce qu’on fait si l’enfant est déjà dans le système ou a fréquenté très jeune la garderie?
Qu’est-ce qu’on doit décoder?
L’enfant qui ne va pas bien est peut-être l’enfant qui ne fait pas confiance. Par exemple, un enfant qui est turbulent à l’école, qui écoute mal son professeur, peut être facilement diagnostiqué comme un enfant hyperactif, alors que ça en est pas nécessairement un. C’est peut-être un enfant anxieux, qui s’ennuie. L’enfant qui s’est habitué à survivre tout seul est un enfant qui n’exprimera pas nécessairement sa détresse et son désarroi, il va le garder pour lui et ça va le faire bouger beaucoup, être attentif, faire le stupide. Cet enfant ne veut pas déplaire, il est bon pour son parent, il a peur du rejet. Je dirais qu’il y a beaucoup d’anxiété qu’on doit dépister. Il ne s’agit pas d’intervenir toujours chimiquement ou médicalement, il s’agit de reprendre du temps avec l’enfant. On ne peut pas récupérer tout le temps perdu, sauf qu’on peut arriver à panser des blessures. Je dis souvent aux parents, vous ne pouvez pas régler 100 % du problème, mais vous pouvez en régler 95 %. On a une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Et les moyens, ils peuvent les prendre en allant au gymnase le soir avec l’enfant, en prévoyant une heure de jeu avec lui quand on le retrouve au bout d’une journée avec de lui demande de faire ses devoirs ou de manger, en fermant la télévision, en mangeant le plus souvent possible avec lui, c’est-à-dire rétablir les petites brisures dans les liens de confiance. Tranquillement, l’enfant va se retrouver confortable avec son parent, va retrouver cette confiance qu’il a en lui.
C’est difficile à dépister parce que l’enfant aime son parent, mais n’est pas capable de lui dire qu’il ne lui fait pas totalement confiance.
Pour moi, la personne qui est capable de résoudre le problème, ce n’est pas le pédiatre, ce n’est pas le psychologue, ce n’est pas la molécule chimique, c’est le parent qui de par ses attitudes est la meilleure personne pour amener l’enfant vers quelque chose d’autre.
Est-ce qu’un enfant à qui on démontre de l’affection, à qui on donne du temps, qu’on écoute peut être rescapé même s’il fréquente la garderie?
Si l’enfant, après l’âge de 7-8 mois, trouve auprès d’une bonne éducatrice de l’affection, de l’encadrement et de la stimulation, qu’il voit son parent plus qu’une heure le soir et qu’il n’a pas eu de problème particulier (prématurité, maladies, etc.), cet enfant-là ne subira pas de conséquences, tout comme la majorité des enfants.
Et vous savez, il y a une grosse différence entre 6 heures et douze heures par jour, à la fin de la semaine! Ce qui est important de réaliser, c’est quel a pensée symbolique, c’est-à-dire la capacité d’imaginer son parent quand il n’est plus là, arrive seulement à 18 mois. Un enfant de 14 mois par exemple, dont le parent est parti, au bout de 15 minutes, est incapable de penser à lui! Il peut retrouver les gestes d’affect à travers une autre personne et il n’en souffrira pas. Sauf que s’il n’a pas une bonne éducatrice ou si on change trop souvent d’éducatrices dans la journée et dans la semaine, cet enfant-là se rebiffe et peut développer les symptômes dont on parlait plus tôt. C’est normal pour un enfant de mal réagir à une éducatrice qu’il ne connaît pas pendant des semaines. Ça peut prendre un mois ou deux avant qu’un enfant se retrouve en situation de confort.
Il ne s’agit pas d’être pour ou contre les garderies. Il faut simplement réaliser qu’il faut au départ être pour son enfant et que si on le confie à quelqu’un, il faut que cette personne-là puisse faire une équivalence maternelle fort importante.
Vous dites même qu’un enfant qui n’est pas adapté à sa garderie après un mois est un enfant normal…
Tout à fait. Entre l’ajustement et l’attachement, il y a un monde. C’est tout à fait normal pour un enfant de moins de 18 mois, dans le mois, 2 mois et même 3 mois qu’il vient d’être mis à la garderie, de faire des crises et d’essayer de voir si les gens l’aiment. Et à ces crises, l faut répondre avec énormément d’encadrement et de contenance, avant de pouvoir le discipliner. On ne peut pas discipliner un enfant qui ne nous fait pas confiance. L’enfant qui ne veut pas déranger est l’enfant qui s’ajuste, s’adapte et se dit en lui-même, « je ne peux pas confier ma détresse à cette éducatrice, je vais donc me taire, fermer ma gueule, ne pas faire de crise », et cet enfant-là gère lui-même son stress. L’enfant de moins de 18 mois qui ne pleure pas quand on l’emmène à la garderie, pour moi le pédiatre, c’est l’enfant qui m’inquiète. Si l’enfant crie, il est en train de vous demander « est-ce que tu m’aimes? ». Si l’enfant ferme sa boîte, c’est qu’il se dit « vous ne m’aimez pas et je vais garder ça pour moi ». Sa conclusion est tirée.
Un exemple facile, c’est l’enfant qui tient prématurément, rapidement son biberon. Les gens voient ça comme une bonne nouvelle « c’est l’fun, il tient son biberon! ». Non! Un enfant de 12-13 mois qui vient de perdre sa maman qui est partie depuis 15 minutes se dit « Coudonc, elle est partie, je vais m’occuper de moi tout seul ».Il faut au contraire, l’assister pour lui dire « oui tu peux le prendre tout seul ton biberon, mais je suis là pour t’aider parce que tu es trop petit.
Vous savez que 6 des 10 médicaments les plus prescrits au Québec pour la petite enfance sont des médicaments pour l’humeur ou le comportement? Il y a un lien direct avec le stress des enfants qui vient d’abord du milieu familial et des différents milieux de vie, dont la garderie – la garderie ne donne pas tous les problèmes, je dis bien DONT la garderie – et pourquoi la garderie? C’est beaucoup une question de temps passé à l’extérieur du cercle familial. C’est pourquoi le temps de qualité et le temps en quantité sont des arguments fort importants à mettre de l’avant.
Vous avez de l’espoir pour l’avenir?
Je suis un gars extrêmement positif, qui respire le bonheur et qui dans l’adversité et le chaos comme dans la lumière et l’arc-en-ciel va rester le même, c’est-à-dire debout! Tant que je vais civilement faire quelque chose pour les enfants, je vais rester debout. Si ce que je viens de faire avec Nathalie Collard peut aider d’une certaine façon à respecter les valeurs de la société et que ces valeurs puissent être centrées autour de l’enfance et de la famille, j’aurai peut-être fait quelque chose. Mon travail c’est d’être pédiatre et d’encaisser pour les enfants, de parler pour eux. C’est aussi le travail des parents et d’une société qui veut faire le meilleur. Donc, pour moi, ce qui est important c’est de faire l’action – je vous le disais tantôt, on a une obligation de moyens, pas nécessairement de résultats.
J’ai fait beaucoup de choses dans le passé, mais ce livre-là est la chose la plus importante, en tout cas la plus sentie et la plus vécue, que j’ai faite pour les enfants du Québec. C’est le meilleur de moi-même en tout cas.
ADOPTION
Johanne Lemieux: des outils pour aider les parents adoptants
2004
Par Anne Grange, journaliste
Entrevue avec Johanne Lemieux, travailleuse sociale & Le monde est ailleurs
Extrait de Le Malicieux no 3, Suisse, février 2004
Johanne Lemieux est Canadienne, travailleuse sociale et maman de trois enfants adoptés en Thaïlande, au Cambodge et au Québec, où elle vit. Depuis huit ans, elle a développé à Québec une expertise en postadoption, expertise que l’on s’arrache aujourd’hui dans toute la francophonie.
Ainsi était-elle l’invitée de quelques associations de France et de Belgique en novembre et décembre derniers, pour une série de conférences passionnantes autour de l’enfant adopté et de ses défis d’attachement. Au cours de son voyage en Europe, elle a très gentiment accepté et nous rencontrer et de répondre à quelques questions.
Votre livre écrit avec le Dr. Chicoine et Patricia Germain s’arrête longuement sur les problèmes de santé des enfants adoptés. C’est un peu inquiétant…
Johanne Lemieux : quand dans un livre sur la grosse on lit toues les pathologies qui peuvent être liées à un accouchement, ça fait peur également. Mais dans un cours prénatal, on ne va pas parler aux futurs parents que des accouchements naturels et des mamans qui « ne déchirent pas ». On parle aussi des complications possibles. C’est pareil en adoption. La question de la santé ne doit pas être taboue. Les problèmes existent et il faut sortir de la pensée magique : à quatre ans et demi, un enfant ne croit plus au père Noël! Beaucoup de problèmes peuvent être prévenus : c’est la raison pour laquelle il faut absolument évaluer les enfants qui arrivent. Il s’agit simplement de prendre en charge de façon normale l’accueil d’un enfant qui a des besoins particuliers.
Vous vous intéressez plus particulièrement aux problèmes d’attachement. Quelle est leur fréquence chez les enfants adoptés?
Tous les enfants adoptés arrivent avec des défis d’attachement. Ils ont tous connu eu moins deux ruptures dans leur vie et ils vont devoir apprendre ce que sont un papa, une maman et aussi une maison. Le nier, c’est mettre la tête dans le sable. Mais nos enfants ont aussi des capacités de survie au-delà de la moyenne. Dans 70 % des cas, les problèmes d’attachement disparaissent après la première année d’adoption.
Au Mali, les enfants sont confiés très rapidement à leurs nouveaux parents, parfois quelques heures seulement après la rencontre. Que se passe-t-il dans la tête du bébé qui quitte la pouponnière dans les bras de ses nouveaux parents?
Cette rencontre-là est un choc pour le parent comme pour l’enfant. Il y a énormément de stress. Le parent de son côté est dans l’euphorie d’un moment rêvé. Mais le bébé n’a aucune idée de ce qui lui arrive, c’est un choc incompréhensible. Qui sont ces gens? Pourquoi ils sont là? Vont-ils s’occuper de moi? Qui va me nourrir? L’enfant vit un état de danger au plus profond de son corps. Il part vers un univers kinesthésique totalement inconnu de lui : de ne sont plus les mêmes sons, etc. Ses yeux sont en état d’hyper vigilance. Mais il peut aussi arriver au contraire que le bébé se réfugie dans l’hypersomnie.
Comment faire pour rassurer notre enfant à ce moment-là?
Il y a un moyen d’atténuer ce choc si les parents en sont conscients. Je travaille beaucoup à changer l’interprétation que l’on se fait de ce moment de la rencontre. A ce moment-là, « ma job » de parent, c’est d’apprivoiser un petit animal effrayé. Ce n’est pas de lui demander de m’aimer tout de suite! Le premier travail va consister à lui prouver qu’il n’est pas en danger. Il faut dire à son enfant que l’on comprend son état de choc et le rassurer en lui disant et en lui montrant qu’il sera en sécurité avec nous. Cette rupture nécessaire sans doute la plus belle qui puisse lui arriver, mais ce n’est pas facile.
Les troubles de l’attachement sont-ils moins fréquents quand les enfants sont adoptés très jeunes?
Il y a de meilleures chances avec des enfants adoptés petits, mais ce n’est pas une garantie. J’ai vu des enfants adoptés à l’âge de 4 ou 5 ans s’attacher profondément à leurs nouveaux parents et des bébés accueillis à un mois rencontré de très grandes difficultés. Certains enfants sont plus résilients que d’autres, certains ont eu la chance de rencontrer une nounou qui les a beaucoup investis et grâce à cela ils vont pouvoir faire confiance à nouveau. L’attachement, ce n’est pas de l’amour, c’est de la confiance. Si votre mari vous trompe trois fois, il se peut que vous l’aimiez toujours, mais que vous ne lui faites plus confiance!
Au quotidien, comment peut-on aider nos enfants à prendre ou à reprendre confiance?
Ce qui est important, c’est de répondre de façon rapide, chaleureuse, prévisible et cohérente aux appels de détresse de nos enfants, surtout lorsqu’ils sont encore bébés. Quand l’enfant crie parce qu’il a faim ou qu’il a envie d’être pris dans les bras et qu’il reçoit une réponse rapide, chaleureuse et prévisible, il se dit qu’il vaut quelque chose, qu’il est important et que l’univers n’est pas dangereux. Il développe sa confiance envers le monde extérieur.
La pouponnière qui recueille nos enfants à Bamako manque parfois de moyens, mais nos enfants y grandissent dans un environnement très affectueux. C’est important?
Oh oui! S’il fallait faire une comparaison, je dirais que je préfère vraiment un enfant qui aura peut-être manqué un peu de nourriture, mais qui n’aura pas été négligé émotivement. Le fait d’être porté et d’être bougé est excellent pour le développement affectif de l’enfant.
Quels sont les signes qui doivent nous inquiéter chez nos enfants?
Il y a plusieurs choses qui peuvent mettre les parents en alerte. Le contact visuel est extrêmement important. Il y a des parents qui me disent au sujet de leur enfant « il n’aime pas regarder dans les yeux, je respect ça ». Moi je dis non! Il faut l’obliger à regarder dans les yeux. La façon dont un bébé se laisse ou ne se laisse pas prendre dans les bras nous apprend beaucoup de choses. Un enfant qui montre de l’ambivalence dans la façon de s’abandonner, qui conserve toujours une certaine raideur et n’arrive pas à se détendre, c’est mauvais signe. Mais le contraire, c’est-à-dire des petits velcros qui s’accrochent de façon maladive, n’est pas bon non plus. Un enfant qui n’entre pas facilement dans une routine et pour qui tout est imprévisible ne fait pas encore confiance à son nouveau parent. Il sursaute facilement, il est en état d’hyper vigilance. Un enfant qui se console seul, qui veut boire seul, s’endormir seul et ne pleure pas, c’est mauvais signe. Être trop sociable, aller dans les bras de n’importe qui, aussi. Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter dès les premières semaines ni au cours des six premiers mois. C’est si les choses ne changent pas au bout de ce temps-là qu’il faut commencer à chercher de l’aide.
À l’inverse, quels sont les signes qui peuvent nous rassurer?
Un enfant qui va bien est un enfant qui recherche le contact visuel, qui sait lâcher prise et se laisser bercer et que l’on peut consoler facilement. Il hurle parce qu’il a faim, mais il se calme quand il voit sa mère arriver. Son humeur est stable, il est joyeux, aime jouer et ses émotions ne l’envahissent pas toujours.
Quels conseils donnez-vous aux parents qui vont accueillir un enfant?
Je compare les premiers six mois à une période d’allaitement symbolique. Ces premiers mois en famille doivent être d’une grande routine et d’une grande stabilité. Il faut créer autour de l’enfant un monde prévisible. Il est beaucoup plus facile de prévenir les problèmes que de les réparer ensuite. L’adoption prend tout son sens au moment de l’arrivée de l’enfant. Il n’y a là une fenêtre d’opportunité pour la famille qui ne se présentera plus jamais. C’est pour cela que je dis aux parents qui viennent me voir de choisir entre 6 mois de parenthèse et 6 ans de thérapie.
Pas facile pour une maman célibataire de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pendant presque une année comme vous le préconisez…
Je sais! Et d’ailleurs, les mamans qui mettent leur enfant en crèche ne sont pas de mauvaises mères. Mais les gens n’ont vraiment pas assez de congés et cela me fait frémir. Dix semaines, c’est bien trop peu, il faudrait six mois au minimum! Alors, je ne sais pas moi… Demandez votre héritage, vendez votre voiture, faites une brocante, groupez tous vos congés, faites ce que vous voulez, mais arrêtez-vous autant que possible à l’arrivée de votre enfant.
Que peut-on dire à son enfant quand on ne sait rien de son histoire?
Toutes les questions n’ont pas de réponse. C’est d’abord aux parents de faire le deuil de ces réponses pour pouvoir aider leur enfant à faire son propre deuil. On peut imaginer des choses et faire des hypothèses à partir de ce que l’on sait sur les raisons de l’abandon dans le pays d’origine. Mais il ne faut rien inventer. Un enfant qui a été trouvé dans une poubelle le sait au plus profond de lui. On peut dire à son enfant qu’il n’est pas le seul à ne pas savoir. Cela n’enlèvera pas la peine. Il faut apprendre à vivre avec ce morceau de puzzle qui manque. En tant que parent, on voudrait combler cette pièce manquante, on aimerait que nos enfants ne souffrent jamais. Mais il vaut mieux les aider à vivre avec cette absence là et à l’occasion, leur dire qu’ils ont raison d’être en colère et d’avoir peur. La « boîte à racines» ( voir encadré) est un outil important. Même si on n’a pas toutes les infos, on en a quelques une que l’on doit rendre disponibles pour l’enfant.
Quel regard portez-vous sur l’adoption en France?
Je ne sais pas pourquoi mais j’ai un peu l’impression que l’on « pathologise» l’adoption en France. Il y a toujours un jugement qui pèse sur les parents adoptants : comme si ce désir d’enfant là était suspect. C’est quelque chose que j’observe chez les Français en général mais aussi chez ceux-là même qui sont chargés d’accompagner les parents. Par exemple, on dit souvent es adoptant qu’ils feraient n’importe quoi pour avoir un enfant, qu’ils seraient capable d’acheter un bébé, etc. Un autre exemple : le parent d’enfant adopté qui vient demander conseil n’est pas toujours bien reçu. On lui dit qu’il panique pour rien, qu’il consulte trop vite. Or le parent sent bien si son enfant a un souci. Ou alors le psy trouve la maman anxieuse. Il se dit qu’elle est bizarre. Mais si ça fait six mois qu’elle ne dort pas, évidemment qu’elle a l’air anxieuse et fatiguée! Au Québec, il n’y a pas ce regard qui pèse sur les parents.
Peut-on être de bons parents pour nos enfants adoptés?
Absolument! Mais il est important d’être bien outillé. Quand ils reçoivent une formation, 95 % des parents font plutôt les bonnes choses! Alors que quand on ne sait pas, on fait forcément des erreurs.
SOURCE
Grange, A. Johanne Lemieux : des outils pour aider les parents adoptants, Le Malicieux, numéro 3, p 5-7, Suisse, février 2004
ATTACHEMENT
Troubles de l'attachement: comment sortir du silence
2004
Par Silvia Galipeau, journaliste
Source : extrait de La Presse / d’après une interview réalisée avec le Dr Jean-François Chicoine
Québec, le 5 septembre 2004
Un groupe d'entraide pour parents aux prises avec des enfants souffrant de troubles de l'attachement est né cet été. L'objectif? Sortir enfin ce mal du silence. Pétales Québec (pour Parents d'enfants présentant des troubles de l'attachement, Ligue d'entraide et de soutien), une division de l'association flamande Wat Nu, née dans les années 90, laquelle a des ramifications en France et en Belgique francophone, est une toute nouvelle ligue de soutien, comptant à ce jour une dizaine de membres dans la province.
« Nous voulons faire reconnaître l'existence, chez certains enfants, des troubles de l'attachement, lesquels peuvent être diagnostiqués. On espère pouvoir ainsi mettre sur pied des services pour les familles », explique en entrevue Danielle Marchand, présidente du conseil d'administration provisoire du groupe.
Déjà soumis aux regards curieux des voisins, aux jugements parfois hâtifs de leurs propres familles, il n'a pas été facile pour le groupe de s'afficher ainsi en public. « On cherche des gens qui vivent les mêmes choses que nous. Parce qu'on se sent tous jugés », indique Pierre Bleau, son conjoint. « Quand tu t'aperçois que tu es devant un enfant que tu ne peux pas aimer, c'est toi que tu blâmes. Et tu te remets en question face au monde. L'amour ne suffit pas, reprend Danielle Marchand. C'est difficile d'amener ça sur la place publique. On n'a pas le goût, encore une fois, de se faire jeter la pierre.»
Personne n’en parle
Pourquoi cette méconnaissance d'un trouble qui touche tout de même quelque 5% des enfants, selon les évaluations? « C'est un sujet dont personne ne parle, un sujet tabou», reconnaît le pédiatre Jean-François Chicoine, spécialisé en santé internationale et auteur d'un livre sur l'adoption, L'enfant adopté dans le monde.
La théorie de l'attachement, élaborée dans les années 50 par le psychiatre John Bowlby, est mieux connue chez les Anglo-Saxons. Elle a été davantage appliquée aux États-Unis. Résultat? Ici, « c'est sous diagnostiqué, croit le pédiatre. On ne m'a pas enseigné ça dans mon école de pédiatrie. On a appris à soigner les enfants, pas les parents!»
D'où la réticence, chez certains spécialistes, à mettre l'étiquette « trouble de l'attachement» sur certains enfants.
Or, on sait aujourd'hui que tout ce qui peut perturber un enfant durant la grossesse, la naissance, et après, peut avoir des conséquences fondamentales.
De la sécurité affective à l’insécurité
Dans la majorité des cas (chez 65 % des enfants), l'attachement est sain. Chez les autres, l'attachement est qualifié d'anxieux. Pour la majorité de ceux-ci, la difficulté n'a rien de pathologique. Mais chez 5 % des enfants, elle l'est. C'est alors que l'on parle véritablement de « troubles ».
Chez les enfants adoptés (tout particulièrement en provenance de l'étranger), 100 % des enfants ont un mode relationnel dit en « difficulté », signale le pédiatre. Mais avec les parents et grâce à diverses techniques comportementales, il est possible de travailler la relation : on insiste sur l'importance de toucher les enfants, de toujours les regarder dans les yeux, on bannit les poussettes et on ne favorise que les porte-bébés ventraux (qui permettent aux regards de se croiser), on donne des massages quotidiens, etc. Bref, on (re)construit un lien d'attachement.
Mais plus les enfants sont âgés (un enfant adopté à 2 ans est déjà considéré comme « vieux »), plus il a de chances de souffrir, déjà, de véritables « troubles ». Et c'est alors que la thérapie est plus délicate, voire impraticable.
La vie de famille n'est pas pour ces enfants, croit d'ailleurs Jean-François Chicoine. «Les gens ont toujours l'impression que l'amour va tout changer, mais il y a des enfants qui vont mieux évoluer hors d'une famille. Ces enfants ont trop souffert, ils ont été trop longtemps en institution pour profiter des liens d'une famille », dit-il. Si le trouble de l'attachement est tabou, le trouble de l'attachement chez les enfants adoptés l'est probablement doublement. Car les échecs en adoption internationale (évalués entre 0 et 5 %) sont majoritairement attribuables à des troubles de l'attachement, croit le pédiatre. « C'est épouvantable à admettre pour une société. Car non seulement l'enfant a été abandonné par sa propre société, mais en plus, il est abandonné par sa société d'accueil! »
SOURCE
Galipeau, S. Troubles de l’attachement : comment sortir du silence, La Presse, Québec, le 5 septembre 2004
MORCEAUX CHOISIS: ARTICLES
ACTIVITÉ PHYSIQUE
La préparation alimentaire d’un sport d’endurance: la surcharge en glycogène
2008
Par Natalie Lacombe, nutritionniste du sport
Avec Le monde est ailleurs
Servicevie.com, Québec, Canada
Dernière révision : 15 janvier 2008
Avant un marathon, les athlètes doivent remplir à pleine capacité leur réservoir d’énergie musculaire. Même les sportifs qui prévoient des performances plus humbles pourraient bénéficier de cette préparation : la surcharge en glycogène.
Pour bien recharger sa batterie, mieux vaut d’abord la vider : c’est comme un téléphone cellulaire.
3 jours avant l’épreuve
Ainsi, trois jours avant l’épreuve, on épuise ses réserves de glycogène musculaire en faisant un entraînement long et intense comme courir, skier ou pédaler à haute intensité pendant 90 à 120 minutes. Tout de suite après, on consomme 1 g de glucides par kg de poids corporel, à toutes les heures. Pas de panique ! Un exemple suit ce paragraphe… Idéalement, on brise la dose en deux et on en prend la moitié à chaque demi-heure. On suit cette prescription dès la minute qui suit la fin de l’entraînement et pendant les quatre heures qui suivent. Ouf ! Voici l’exemple pour démêler tout ça.
Vous êtes un triathlète de 70 kilos
L‘image vous plait ? Alors allons-y.
Ça fait deux heures que vous courez, il est 10 heures. Stop ! On mange : le protocole commence dès maintenant.
Vous devez boire ou manger tout de suite 35 g de glucides, puis recommencer à toutes les demi-heures pendant 4 heures : à 10 h 30, 11 h, 11 h 30, 12 h, 12 h 30, 13 h, 13 h 30 et 14 h. Vous aurez alors consommé un total de 315 g de glucides. Le tableau qui suit propose un choix d’aliments glucidiques.
Quelques aliments riches en glucides
Aliments |
Glucides |
80 ml (1/3 tasse) de pâtes alimentaires, couscous, riz, cuits |
15 g |
1 tranche de pain (30 g) |
15 g |
½ petit bagel, ½ muffin anglais, ½ pita |
15 g |
125 ml (1/2 tasse) de jus ou de fruits en conserve |
15 g |
1 fruit moyen |
15 g |
15 ml (1 c. à soupe) de sucre, sirop, miel, mélasse, confitures |
15 g |
30 ml (2 c. à soupe) de raisins ou canneberges séchés |
15 g |
2 dattes, 2 figues ou 3 pruneaux séchés |
15 g |
250 ml (1 tasse) de lait ou boisson de soja |
12 g |
125 ml (1/2 tasse) de légumes |
5 g |
Truc
Comme la régularité est importante, il serait bon de programmer sa montre ou son ordinateur pour une sonnerie à toutes les demi-heures!
Au cours de cette première de journée de préparation, en plus de toutes ces collations, vous devez aussi prendre vos trois repas équilibrés contenant des protéines et peu de gras. On vise un apport total 10 g de glucides par kg de poids corporel. Dans l’exemple du triathlète, il lui faut 700 g de glucidespour la journée. Il en a déjà consommé 315 g au cours des 4 heures qui ont suivi son entraînement. Il lui reste donc 385 g de glucides à consommer à travers ses repas.
Deux jours avant l’épreuve
Il faut du repos et une alimentation riche en glucides. Il suffit de prendre trois repas équilibrés et des collations. On choisit des aliments faibles en gras, riches en glucides et on prend une bonne source de protéines (viandes maigres, volailles sans la peau, poissons, légumineuses, tofu, œufs) à chacun des repas. On ne coupe pas sur le sel qui est important pendant l’effort, et on boit beaucoup.
La veille de l’épreuve
Repos complet et glucides en abondance. On reprend le modèle alimentaire précédent et on se détend. Il est préférable d’éviter l’alcool la veille d’une compétition importante.
Le matin même de l’épreuve
Avec une bonne préparation, on se réveille avec des réserves de glycogène musculaire bien remplies. Mais tous ces efforts n’auront servi à rien si on n’arrive pas à recharger le réservoir de sucre dans le foie. Le hic, c’est que celui-là ne peut pas être rempli à l’avance. Il faut donc savoir quoi manger avant l’effort dans les heures qui précèdent la compétition.
Le lendemain de l’épreuve
Vous êtes déjà sur la plage à Hawaï avec l’argent que vous touché en gagnant l’épreuve d’hier. Bonnes vacances!
SOURCES
Burke, L. Practical Sports Nutrition. Human Kinetics, 2007, 530 p.
Burke, L. & V. Deakin. Clinical Sports Nutrition, 3rd edition. McGraw-Hill, 2006, 822 p.
Ledoux, M., Natalie Lacombe et Geneviève St-Martin. Nutrition, sport et performance. Géo Plein Air, 2006, 260 p.
Rosenbloom, C.A. Sports Nutrition : a guide for the professional working with active people. 3rd ed. ADA, 2000, 759 p.
HYGIENE
Se laver les mains pour rester en santé
2008
Par Nadia Desmarais Infirmière B.Sc., CHU sainte-Justine, Montréal, Québec, Canada
Avec Le monde est ailleurs
Extrait de Servicevie.com, Québec, Canada
Dernière révision : 14 janvier 2008
Dans l’histoire de l’humanité, les maladies de l’hygiène ont fait des millions de morts, prélevant un monstrueux tribut dans l’enfance, notamment. Au dix-neuvième siècle, la science commence à opposer une arme efficace contre une bonne partie des fléaux qui affligent les humains : le lavage des mains.
Les mains sont une merveilleuse courroie de transmission pour les bactéries et les virus.
La contamination est partout
Nous avons sur nos mains une quantité importante de bactéries qui se divisent en deux catégories ; celles qui y habitent et celles qui y sont de passage. Des bactéries normales de la peau vivent sur nos mains et servent à nous protéger en ne laissant pas trop de place aux bactéries et virus qui sont de passage sur nos mains mais qui peuvent nous rendre malade. Tout au long de la journée, nous touchons à une multitude de choses contaminées, c’est de cette façon que nous attrapons ces microbes indésirables. Pour s’en débarrasser, nous devons nous laver les mains plusieurs fois par jour. En fait, l’hygiène des mains est le moyen le plus efficace, le plus rapide et le moins coûteux pour diminuer la transmission des infections entre les personnes (voir l’article sur Ignace-Philippe Semmelweiss, pionnier de l’asepsie).
L’hygiène des mains est le nouveau mot à la mode que nous utilisons pour parler du lavage des mains à l’eau et au savon et de la désinfection des mains avec les produits à base d’alcool (ex. Purell ®).
L’action du savon
Dans la vie quotidienne ; à la maison, à l’école, au travail, le lavage des mains à l’eau et au savon demeure la mesure la plus recommandée. Lorsque les mains sont sales, il est absolument nécessaire de les frotter afin de déloger les saletés qui sont ensuite capturées dans les petites bulles de savon pour finalement être éliminées par l’eau courante. Les savons qu’on peut utiliser dans la vie de tous les jours se présentent sous deux formes : liquide ou en pain de savon.
Le savon liquide qui se présente dans une bouteille avec pompe a l’avantage de toujours fournir une dose de savon propre. Le pain de savon est, quant à lui, souvent incrusté de saletés, surtout lorsque plusieurs personnes l’utilisent. Si, à la maison, vous optez pour le pain de savon pour le lavage des mains, il devrait être changé régulièrement et ne pas être utilisé pour la douche ou le bain des membres de la famille.
L’alcool qui tue
Il a été démontré par plusieurs experts que les désinfectants à base d’alcool sont très efficaces, car leur activité antimicrobienne est immédiate. Par contre, ils ne peuvent être utilisés sur des mains sales. Ils doivent être utilisés sur des mains visiblement propres car les saletés encapsulent les microbes et empêchent le produit désinfectant de les détruire. Ces produits sont très pratiques dans le sac à mains, la voiture ou lors d’un pique-nique en famille où il sera impossible de se laver les mains à l’eau et au savon avant de manger. Une autre solution pour les sorties ou activités extérieures est l’utilisation de lingette humide (ex. Wet ones ®). Souvent, lors de ces activités, les mains des enfants sont sales et comme il est important de débarrasser les mains des souillures, l’utilisation des lingettes est préférable.
Les occasions pour se laver les mains au cours de la journée sont nombreuses : avant de manger, après être allé à la toilette, avant et après la manipulation des aliments, après s’être mouché, en entrant à la maison après avoir voyagé dans les transports en commun, etc.
Une bonne nouvelle pour la société, depuis quelques années, les enfants qui fréquentent les garderies apprennent très jeunes l’importance du lavage des mains et c’est devenu une bonne habitude de vie pour plusieurs d’entres eux.
Il ne faut pas en faire une maladie, et je ne parle pas que des japonais… mais la pratique quotidienne de l’hygiène des mains est à la base d’une vie saine !
ADOLESCENCE
La dysménorrhée, règles douloureuses
2008
Par Joanne Proulx, médecin de famille, Longueuil, Québec, Canada
Avec Le monde est ailleurs
Extrait de Servicevie.com, Québec, Canada
Dernière révision : 12 janvier 2008
La vie d’une jeune fille obéit à des règles bien naturelles. D’un siècle à l’autre, c’est pareil.
Nous sommes en 1930. Juliette a 12 ans, elle est à sa petite école du village. Elle y apprend des règles de grammaire, des règles de mathématiques, des règles de morale, etc.
Elle est une élève modèle, appliquée, ponctuelle et ses devoirs sont toujours exécutés dans les règles. Par contre, dans sa classe, il y a Rodolphe, un élève agité qui ne respecte aucune règle et qui semble insensible aux coups de règle sur les doigts donnés par la maîtresse…
La dysménorrhée
Un jour, Juliette ressent une vive douleur dans le bas ventre et un écoulement de sang s’installe. Elle comprend qu’à grand coup de règle, elle vit sa première menstruation. Elle a sa « ménarche » et la douleur se nomme la dysménorrhée. Elle devra revivre cette situation tous les mois, c’est la règle !
La douleur varie d’une jeune fille à l’autre. Elle se présente sous forme de crampes sus-pubiennes. Il s’agit de contractions de l’utérus induites par les prostaglandines, des substances qui nuisent à la vascularisation de l’utérus. La dysménorrhée est reconnue comme étant une des causes d’absentéisme les plus fréquentes chez les adolescentes à l’école.
L'endométriose
Une autre condition médicale qui est souvent associée à la dysménorrhée est l’endométriose. C’est une maladie sournoise qui consiste en dépôts de tissu endométrial à l’extérieur de l’utérus et qui produit des sites inflammés lors de la menstruation.
En règle générale, les traitements sont très efficaces. Il y a la médication, avec les anti-inflammatoires qui ont un effet anti-prostaglandines ; il y a les contraceptifs oraux qui modifient le statut hormonal ; pour les plus vieilles, il y a le stérilet à base de progestérone, etc.
Un bon médecin qui suit les règles de l’art sera à l’écoute de cette condition qui constitue un phénomène médical et social dont l’incidence n’est pas négligeable. La règle d’or est de ne pas sous-estimer cette condition.
Juliette devra suivre les règles du jeu, elle est devenue une femme.
Rodolphe l’a remarqué…
ADOLESCENCE
Sexualité à l'adolescence: Butter face
2008
Par Grégoire Viau, rédacteur et scénariste
Source : Défendre les Zéro@18 sur www.meanomadis.com
Québec, 14 décembre 2008
Avoir des enfants, c’est passer des nuits blanches (3 hommes et un couffin), ça coûte cher (Alberto Express) et ça risque brouiller l’écran de télé (Poltergeist). Mais ça finit toujours par payer (« Maman Dion », par Georges Hébert Germain). En mots, notamment.
Je suis père d’une adolescente et ex-bénéficiaire de soins pédiatriques (fracture de la jambe à dix ans). Si je n’avais pas cette fille, « ma fille » de 16 ans en 2008, je ne sortirais pas souvent d’un monde situé entre Don Quichotte (1615) et à la recherche du temps perdu (1927), avec beaucoup de temps perdu en compagnie d’Alexandre Dumas (1802-1870).
Palazzo basse-taille
Heureusement, ma fille me rappelle de temps en temps à la réalité de ce début de troisième millénaire : sans elle, je serais mort de vieillesse sans jamais avoir entendu parler de la chanteuse Feist, de l’acteur Rupert Grint et sans savoir que le palazzo basse-taille commençait a fini par céder au retour des pantalons cigarettes (c’était MON adolescence, ça !)
Nu de femme
Ma fille sort de son cour de dessin (je n’habite pas Saint-Lambert : toute de suite on pense au précepteur de Natasha Rostov, mais ma fille fréquente la polyvalente). Elle devait dessiner un nu d’homme et un nu de femme, à partir d’un dessin (le modèle vivant, c’est pour les livres).
Quand son dessin fut complété, elle le montra à son voisin, un jeune homme qui, comme elle, fréquentait la polyvalente, et qui était donc, comme elle, de basse extraction. Ma fille était satisfaite de son corps de femme (dessiné) : il représentait bien le modèle donné, les épaules avaient la même largeur que les hanches, la tête rentrait bien huit fois dans le corps. Mais le visage était raté : le nez était trop gros, et les yeux, asymétriques, donnaient une expression de méchanceté à toute la personne, un peu comme la Gertrude Stein de Picasso.
Son voisin approuva les jolies proportions du corps et en félicita ma fille. Mais, regardant le visage de plus près, il lui dit : « C’est une but her face »
« Face de beurre ? » demande ma fille, qui ne voyait pas le rapport.
« Non, pas butter face » mais « but her face » : tout est beau, sauf son visage. Everything looks good, but her face ».
Bien qu’ils n’aient pas beaucoup de vocabulaire, les jeunes, comme l’anglais, ont toujours le mot juste.
SOURCE
Viau, G. Butter face, Défendre les zéro @ 18 sur Abandon, Adoption, Autres mondes, www.meanomadis.com, Le monde est ailleurs, Québec, 2008
CHIRURGIE
Appendice, appendite, appendicectomie
2007
Par Claude Baril, chirurgien
Hôtel-Dieu Arthabaska, Victoriaville, Québec. Canada
Avec Le monde est ailleurs
Extrait de Servicevie.com, Québec, Canada
Dernière révision : 20 novembre 2007
« Terminer ses jours le corps barré »… Les auteurs de l’Antiquité faisaient déjà allusion à ces douleurs à la fosse iliaque droite caractéristiques de l’appendicite. L’humanité en a toujours souffert ! Aujourd’hui des gens s’étonnent qu’un enfant puisse mourir d’une appendicite aiguë. Pourtant cela n’étonnait personne avant le vingtième siècle. Comment la médecine en est-elle venue à traiter ce mal ?
Par l’intensité des douleurs qu’elle provoque et par les nombreux décès qu’elle a engendrés au cours de l’histoire, l’appendicite a toujours tourmenté l’humanité. Elle a aussi donné passablement de fil à retordre aux médecins qui ont mis des siècles à trouver la cause de tant de mal et qui n’intervenaient que dans les moments extrêmes, quand l’abcès abdominal était sur le point de leur exploser au visage.
On a pratiqué des drainages d’abcès à la fosse iliaque droite depuis l’Antiquité. À une époque, on faisait même avaler des billes de plomb aux patients pour tenter de débloquer leurs intestins obstrués par l’inflammation. Les médecins arabes utilisaient quant à eux la chaleur des cataplasmes pour faciliter la rupture externe de gros abcès débordant la paroi abdominale.
Les premières descriptions de l’appendice
C’est au seizième siècle que l’on retrouve les plus anciennes descriptions anatomiques de l’appendice. En 1561, Fallopius (qui a aussi donné son nom aux trompes utérines) a comparé l’appendice à un ver, d’où le nom d’« appendix vermiformis ». Certains écrits du réputé père fondateur de la chirurgie, Ambroise Paré, datant de 1582, donnent aussi une description de l’appendice, du cæcum et du colon droit.
McBurney : un nom pour la postérité
Il aura fallu des siècles de recherches et de confusion pour établir une relation de cause à effet entre la structure anatomique qu’est l’appendice et cette entité clinique souvent mortelle qu’est l’appendicite aiguë. Ce n’est qu’en 1886 que Reginald H. Fitz, de l’université Harvard, a formellement établi le lien entre les deux. C’est ensuite Charles McBurney qui, en 1889, a identifié les signes cliniques classiques de l’appendicite. Il a également posé les critères pour son diagnostique précoce et décrit l’incision abdominale à faire pour y accéder.
Ainsi, certains médecins se rendent célèbres en faisant de la politique (Che Guevarra) en écrivant des livres (Spock) en donnant leur nom à un organe (Fallope) ou à une maladie (Alzheimer). M. McBurney, lui, a localisé le point de jonction du tiers externe et des deux tiers externes, le long de la ligne reliant l’épine iliaque antéro-supérieure droite à l’ombilic. Pour cet exploit, la postérité retiendra à jamais son nom. Tous les médecins, en tout cas, le connaissent et l’ont intégré à leur jargon (quasi) quotidien : devant une appendicite à un stade avancé, évaluant la douleur du patient, ils diront tout simplement : « C’est un McBurney positif », ou encore : « C’est un McBurney négatif ».
Depuis quand le bistouri ?
Même si l’appendicite n’est vraiment comprise que depuis 1886, la première ablation de l’appendice fut décrite par Claudius Amyand en 1735 : réparant une hernie inguinale, il l’avait alors retirée parce qu’elle était sur son chemin dans le sac herniaire. Mais la première appendicectomie effectuée dans son vrai contexte clinique pour une appendicite suppurée, comme on la pratique aujourd’hui en ligaturant celle-ci à la base du cæcum, a été décrite par G. Morton de Philadelphie en 1887.
Grandes incisions, petites incisions
La technique de la laparotomie, l’incision de l’abdomen, s’est passablement raffinée de 1887 à nos jours. Autrefois, on disait : « Grand chirurgien, grande incision ». De nos jours, les soucis de l’esthétique exigent les plus petites ouvertures possibles, ce à quoi la technologie moderne contribue grandement.
Depuis moins d’une quinzaine d’années, on pratique l’appendicectomie par laparoscopie : une technique où l’on insuffle la cavité péritonéale pour la gonfler afin d’y introduire, par de toutes petites incisions, des trocarts munis d’une caméra et d’instruments chirurgicaux : la caméra projette l’image de la cavité abdominale et guide la main du chirurgien.
Le but de l’appendicectomie est de ligaturer l’appendice à sa base, au niveau de son implantation dans le cæcum, en attachant celle ci à l’aide d’une suture en forme de lasso. On sectionne ensuite l’appendice, on la place dans un petit sac et on l’évacue par une ouverture à l’ombilic. Pour les cas d’appendicite non perforée, le traitement se fait en chirurgie d’un jour. La récupération est rapide et laisse peu de séquelles.
En raison des connaissances très précises qui ont été acquises au fil des siècles et des outils très performants dont nous disposons aujourd’hui pour l’opérer, les gens ont tendance à banaliser l’appendicite. Compte tenu des conséquences d’une appendicite non traitée, c’est pourtant bien loin d’être banal. Une banalité qui affecte pourtant près de 7% de la population et qui cause encore 0.3% de mortalité…
À quoi ça sert?
N’importe qui d’entre nous peut se lever un bon matin, en pleine forme, et terminer sa journée avec une péritonite sur une table d’opération, avec du pus partout dans le ventre. Et mourir peut-être ! Heureusement, à notre époque en Occident, l’issue d’une appendicite est rarement aussi dramatique. Mais à quoi peut bien servir l’appendice à part tourmenter le péritoine et exercer l’adresse du chirurgien ?
L’appendice est un tout petit organe longiligne, en forme de ver (vermiforme) situé au pôle caecal du côlon droit : une petite queue de 7 à 10 centimètres de long qui pendouille dans le bas du ventre.
Certains ne voient en l’appendice qu’un vestige de l’évolution. Il y a pourtant une ouverture à la base de l’appendicequi déverse son contenu sécrétoire directementdans la lumière du colon. L’appendice n’est donc pas qu’un dinosaure : il fait partie intégrante du tractus gastro-intestinal (système digestif) au même titre que le rectum ou l’estomac. Comme peu d’animaux en sont pourvus, ils n’ont pas pu renseigner les chercheurs sur sa fonction, à l’instar des rats et des lapins qui nous ont révélé tant de secrets sur notre propre anatomie. On sait que l’appendice fabrique des immunoglobulines, comme bien d’autres organes, mais pas assez pour jouer un rôle signifiant dans le système immunitaire. À quoi sert-il alors notre appendice, sinon à s’infecter?
L’appendice, caserne de réservistes?
Il n’y a pas longtemps, deux chercheurs américains prétendaient finalement avoir mis le doigt sur la fonction de l’appendice. Dans les intestins, ce sont des bactéries utiles qui terminent le travail de la digestion. Selon ces deux chercheurs, l’appendice abriterait lui aussi ses bactéries, mais qui feraient ici office de matériel de secours pour venir à la rescousse de la flore intestinale dévastée, lors d’une diarrhée par exemple. Pure spéculation, malheureusement. De l’avis général, l’hypothèse ne tient pas la route, notamment car les patients appendicectomisés n’ont aucun problème à refaire leur flore intestinale suite à une purgation du tube digestif. On est encore bien loin d’avoir trouvé un sens à la vie de l’appendice.
En attendant, ça n’empêche pas les appendicites…
Quand l’appendice est bouché, le ventre éclate !
De temps en temps, un amas de matières fécales, appelé fécalite, vient obstruer l’ouverture de l’appendice, qui se distend sous la pression des sécrétions emprisonnées. C’est ce qui provoque le plus souvent l’appendicite aiguë.
Le tableau clinique classique est celui d’un individu qui se présente parce que depuis moins de 24 heures, il a ressenti une douleur vague d’abord s’installée dans l’épigastre (le creux de l’estomac). La prolifération bactérienne accentue la distension de l’appendice et congestionne les vaisseaux sanguins, perturbant du coup l’apport du sang. L’appendice s’enflamme, l’inflammation traverse son enveloppe et gagne les parois abdominales : en quelques heures, parfois plus, la douleur se déplace alors vers la fosse iliaque droite ; à ce stade, le patient se tient souvent couché sur le côté, les jambes repliées sur lui-même, dans la position du chien de fusil. Il ne pose pas : c’est qu’il a vraiment mal. Il peut y avoir de la fièvre, une altération de l’état général et les douleurs sont accentuées à la mobilisation.
Si elle n’est pas traitée, la congestion des vaisseaux entraîne une ischémie : le sang qui ne passe plus n’irrigue plus l’appendice dont les cellules manquent d’oxygène. L’appendice, nécrosé, craque alors, et tout ce qu’il contient se déverse dans la cavité péritonéale : voilà ! Comme dans un mauvais film policier, la fin était prévisible, et vous avez tout de suite vu venir la péritonite… Le pus se répand dans l’abdomen, et il faut opérer d’urgence.
Qui en fait ? Comment on sait ?
L’âge moyen pour l’appendicite aiguë se trouve entre 10 et 30 ans. Cependant, on rencontre des cas aux extrêmes de la vie. Le patient le plus jeune que j’ai opéré pour une appendicite était âgé de 2 ans, et ma doyenne en avait 98.
Le patient se plaint le plus souvent d’une douleur à droite dans le bas du ventre. Mais il faut savoir que bien souvent, l’expression de la maladie est frustre ou imprécise et qu’il faut de l’expérience pour diagnostiquer cette entité pathologique. L’examen de l’abdomen présente des signes cliniques spécifiques dont la douleur à la fosse iliaque droite avec défense musculaire, le signe de McBurney et une douleur qui se réfère à droite en palpant la fosse iliaque gauche, ce qu’on appelle, le signe de Rovsing.
Aux examens de laboratoire, la formule sanguine révèle une légère hausse du taux de globules blancs, entre 10000 et 18000 pour tout vous dire. L’échographie et la tomographie axiale (CT-Scan) peuvent confirmer les appréhensions ou mettre le doigt sur un autre problème, une infection des trompes utérines par exemple Dans les cas incertains, la meilleure attitude est l’observation L’œil du médecin expérimenté reconnaît vite, à son évolution, la nature du mal. La pathologie évolue dans le temps et le diagnostique se précise graduellement pour qui sait attendre.
Comment traiter le problème ?
De nos jours, le traitement d’une appendicite est l’appendicectomie : aux poubelles, le vestige ! On va retirer l’appendice en ouvrant carrément le ventre : c’est ce qu’on appelle une laparotomie ; ou encore, on fait de plus petites incisions et c’est une caméra miniature qui guide à distance la main du chirurgien : ce type d’opération s’appelle laparoscopie. L’utilisation d’antibiotiques s’avère souvent nécessaire comme traitement d’appoint.
Pourquoi s’embêter d’une appendice ?
Cette apparente simplicité amène souvent les gens à nous questionner sur les appendicectomies prophylactiques. « Docteur, je pars pour un long voyage dans un pays dont je redoute les services de santé. Je ne voudrais pas mourir d’une simple appendicite pendant mon voyage. Puisque l’appendicectomie par laparoscopie est si simple, pourquoi ne pas m’enlever l’appendice avant qu’elle ne s’enflamme ? »
Oui, c’est vrai, on peut le faire mais, c’est une question de risques et de bénéfices. Toute chirurgie abdominale s’accompagne malheureusement d’un potentiel de complications.
Celles-ci sont de l’ordre de 3%, allant de la simple infection de plaie jusqu’à la mort par embolie pulmonaire. Le risque de faire une appendicite aiguë sur 6 mois de vie est d’environ 0.02%.. Il n’y a pas de prévention possible. Le traitement antibiotique seul, sans la chirurgie, peut permettre d’acheter du temps pour se rendre dans un centre de soins de santé. L’ablation préventive est donc un choix personnel que l’on ne doit faire qu’après mûre réflexion.
SOURCES
Rev Prat 2001, 50(1): 101. Epipath.net
Principles of Surgery, Schwartz, Shires & Spencer.
Arthur C McCarty MD, University of Louisville, Presented to the Innominate society.
Atlas of Human anatomy, Frank H Netter, MD
Principles of Surgery, Schwartz, Shires & Spencer.
Arthur C McCarty MD, University of Louisville, Presented to the Innominate society.
Sur les travaux des docteurs Parker et Bollinger, de l’Université Duke, à propos du rôle de l’appendice : “Appendix Isn’t Useless at All: It’s a Safe House for Bacteria” consulté en ligne sur le newsletter de l’université :
http://www.dukemednews.org/news/article.php?id=10151
NUTRITION
Le fer, le nouveau-né et sa maman
2004
Par Jean-Francois Chicoine
Source: Magazine Bébé Nestlé, Nestlé Canada
Canada 2004
La mission la plus importante du fer est de constituer l’hémoglobine des globules rouges du sang. Un manque de fer entraîne de l’anémie chez le nourrisson.
Le problème a son importance quand on sait que ce sont les globules rouges qui transporte l’oxygène vers toutes les cellules de l’organisme, y compris vers celles du jeune cerveau en croissance.
Q Un enfant anémique est-il moins en forme ?
R L’enfant est affecté par la carence en fer. Jeune, il paraît déjà pâle, irritable, trop gros ou trop maigre. Un manque d’appétit et une certaine passivité s’installent. Tant d’un point de vue moteur que de son éveil intellectuel, l’enfant anémique prend du retard. Il ne joue pas comme les autres et développe ultérieurement des problèmes d’apprentissage
Q Existe-il des bébés à risque ?
R Les enfants prématurés sont particulièrement à risque d’anémie du fait que leurs réserves en fer ne sont pas aussi grandes que celles des nouveau-nés à terme. Mais l’essentiel à retenir c’est que tous, je dis bien tous les nourrissons qui n’ont pas été allaités ou qui n’ont pas bénéficié d’une formule lactée pour nourrissons enrichie en fer sont à risque de carence en fer. C’est donc beaucoup d’enfants, beaucoup trop: des milliards d’enfants dans le monde et des milliers au Canada, jusqu’à un sur cinq, même un sur quatre dans certains quartiers de Montréal ou de Toronto !
Q Comment s’assurer que le nouveau-né ne manque pas de fer ?
R Sa maman, à condition d'etre bien supportée, est la mieux placée pour y voir. Comment ? En allaitant son bébé. De fait, la meilleure façon de prévenir la carence en fer chez l’enfant est de l’allaiter exclusivement jusqu’à l’âge de 6 mois. Ce n’est pas que le lait maternel soit spécialement riche en fer, mais la forme sous laquelle il est livré par le sein maternel, est conçue spécialement pour être mieux absorbée par l’intestin du bébé. À l’âge de 6 mois, ou avant si l’enfant est né avec un petit poids de naissance ou si sa maman souffre d’anémie, d’autres sources de fer devront être proposées: les céréales pour bébé enrichies en fer (d’ailleurs les préférés jusqu’à 2 ans), puis la viande, le jaune d’œuf et les légumineuses. C’est entre l’âge de 7 mois et leur premier anniversaire que les besoins en fer des nourrissons sont à leur maximum.
Q Comment faire si bébé n’est pas allaité ?
R Aux enfants qui n’auraient pas la chance d’être allaités, une préparation lactée pour nourrisson enrichie en fer s’avère le choix incontournable. Le lait de vache est un excellent aliment, mais une mauvaise source de fer incorrectement absorbée par le tube digestif. À la longue, le lait de vache favorise également une perte substantielle de sang par l’intestin. On ne devrait donc pas en offrir aux nourrissons de moins de 9-12 mois et éviter la consommation excessive par la suite, c’est à dire plus de 750 ml à un litre par jour.
Q Les formules enrichies en fer causent-elles de la constipation ?
R Non, contrairement à ce qu’on entend dire, de nombreuses recherches ont confirmé que ces préparations enrichies en fer ne causaient ni constipation, ni coliques, ni quoi que ce soit d’autre. Si ( ET SEULEMENT SI…) une maman se voit dans l’impossibilité d’allaiter, elle ne devrait pas hésiter à les choisir. L’avenir du bébé en dépend et c'est pas rien!

Archives LMEA Les parents adoptants doivent avoir...
L'express Suisse, Suisse, déc 2009

Archives LMEA Aux petits soins
Canoe/TVA, Qc. 2008

Archives LMEA Nos enfants méritent ce qu'il ya de mieux
Distribution aux consommateurs/Sainte-Justine, Qc. 1992

Archives LMEA Guide d'antibiothérapie partique
De Luc & Jean-Francois Chicoine & Jean Rock Lapointe
Sainte-Justine, Qc. 1889/ 1992
Dernière révision: février 2016
